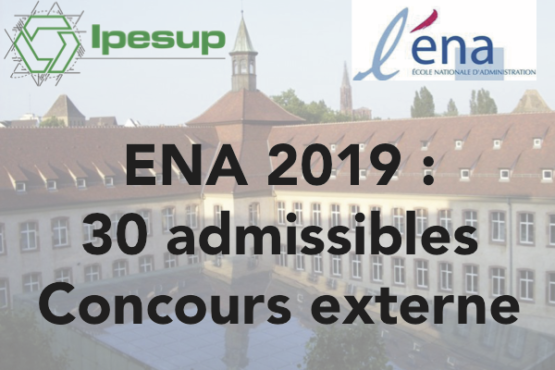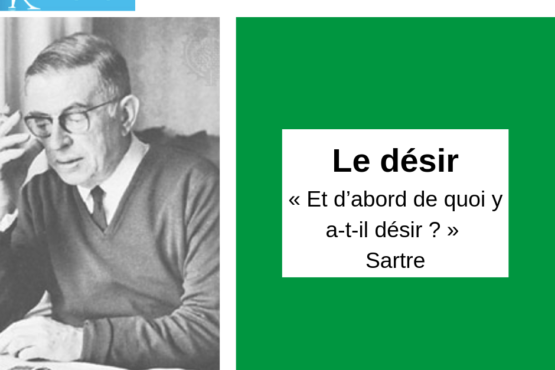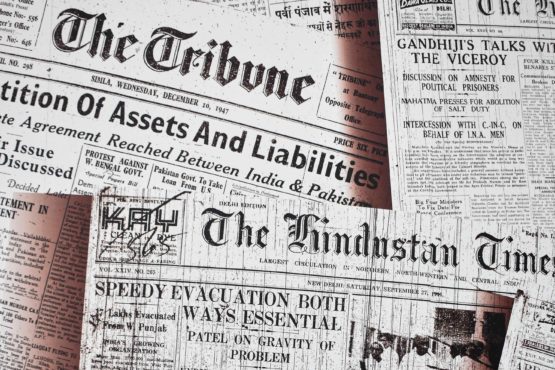En 2019, les résultats record d’IPESUP se confirment avec, une fois de plus, 30 admissibles au concours externe de l’ENA, et cette année 2 admissibles au concours externe spécial « docteurs ».
30 admissibles au concours externe de l’ENA 2019 : 1/3 des admissibles ont suivi la Prép’ENA d’IPESUP
Avec une rigueur métronomique depuis 3 ans consécutivement, l’IPESUP accompagnera vers la réussite 30 admissibles au concours externe de l’ENA.
Ainsi en 2019, un tiers des admissibles en France au concours externe de l’ENA seront passés par les bancs d’IPESUP pour réussir leurs épreuves écrites.
Ces résultats solides et prometteurs prolongent des admissibilités qui progressent de 30 à 40% à l’EHESP ou à l’INET.
IPESUP s’affirme une nouvelle fois comme une préparation d’excellence pour réussir ce concours particulièrement sélectif de l’enseignement supérieur français, et plus généralement les concours administratifs les plus sélectifs de catégorie « A+ » (ENA, EHESP, INET et Banque de France).
Déjà 2 admissibles au nouveau concours des docteurs
Jusqu’à l’édition 2018, trois voies d’admission permettraient d’entrer à l’ENA :
- le concours externe, ouvert à tous, mobilisant des épreuves écrites académiques
- le concours interne, réservé aux agents administratifs, comportant des épreuves plus opérationnelles (synthèses de documents sur la base d’un dossier)
- le « troisième concours« , destiné aux personnes disposant d’une solide expérience professionnelle
IPESUP, un temps d’avance
En 2019, l’ENA décidait d’ouvrir pour la première fois un « concours externe spécial » réservé aux docteurs. L’IPESUP créait rapidement une préparation sur-mesure (ena.france@mail.com) pour accompagner les docteurs vers la réussite à ce nouveau concours.
Le succès de cette préparation peut déjà être salué puisque l’IPESUP aura contribué à rendre 2 docteurs admissibles.
La réforme de la prep’ENA d’IPESUP : un véritable succès au service de nos étudiants
Depuis plus de 15 ans, la Prép’ENA d’IPESUP rassemble autour d’elle des candidats brillants, une équipe de professeurs remarquable et une direction pédagogique dévouée.
Retour sur la réforme de la Prép’ENA en 2018
La réforme de notre Prép’ENA, engagée dès début 2018 par Bertrand Leonard, avait permis de poursuivre l’œuvre des fondateurs Gérard Larguier et Patrick Noël en adaptant l’enseignement et la maquette pédagogique aux nouveaux besoins des élèves. 6 items marquaient l’évolution de la Prép’ENA :
- une équipe pédagogique renouvelée et mixte avec 2/3 d’énarques et 1/3 d’académiques, sous la direction de professeurs remarquables
- la mise en place d’un système de parrainage avec un parrain élève ou ancien élève de l’ENA pour chaque étudiant
- la mise en ligne d’une nouvelle plateforme pédagogique digitale avec des ressources pédagogiques de très haut niveau, notamment des corrigés complets et des copies authentiques (de bonnes à très bonnes)
- un nombre de galops proposés triplé
- l’ouverture de deux modules, pour une meilleure répartition des galops sur l’année
- des corrigés rapides et efficaces des sujets, en moins d’une semaine
Sous cette impulsion décisive, les résultats record d’IPESUP de 2016 et 2017 se confirmaient à l’automne 2018 avec 30 admissibles. 17 candidats furent finalement admis fin novembre, marquant un taux de transformation record entre l’admissibilité et l’admission (56 %, au-dessus de la moyenne nationale de 42 %).
Une édition 2019 particulièrement riche en contenus pédagogiques
Olivier NAFISSI, directeur de notre Prép’ENA, a enrichi l’offre de nouveaux outils, en particulier d’un suivi pédagogique très détaillé de chaque étudiant.
Près de 100 heures de cours et 80 heures de corrigé ont été dispensées par nos intervenants cet été. Pas moins de 19 000 pages ont été lues en l’espace de 11 semaines. Les copies corrigées ont été restituées en-deçà de 7 jours, de façon à être disponibles avant d’assister au cours du concepteur du sujet. Plusieurs rythmes de composition ont été pratiqués, galops à la suite en une semaine, ou différés sur deux semaines et demi, composés en présentiel aussi bien qu’à distance.
La Prép’ENA d’IPESUP a ainsi su maintenir excellence académique et pédagogique, tout en apportant à chaque étudiant une attention individualisée. Le numérique a été pensé comme un outil au service de la pédagogie et de nos élèves.
Des résultats encore plus remarquables pour nos élèves les plus assidus
Il est notable que nos élèves les plus sérieux et assidus, c’est-à-dire ayant assisté à tous les galops du dernier concours blanc, ont, pour 68 % d’entre eux été admissibles à l’ENA, représentant 21 admissibles sur les 30 admissibles de notre promotion 2019. Cela démontre s’il en était encore besoin l’utilité des cours et des galops jusqu’au « dernier jour » de la préparation.
Place désormais aux oraux !
Place désormais aux oraux, avec la même passion de bien former et la même détermination de guider vers la réussite !


 Guides et publications
Guides et publications